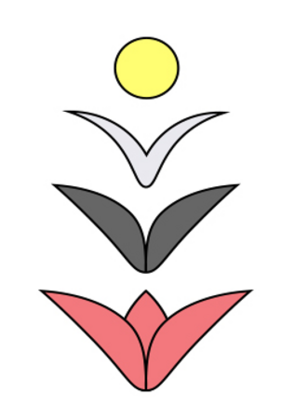Études autochtones à l’UdeM
Bonjour et bienvenue dans notre bulletin de l’hiver 2020!
Nous voulons avec ce numéro parler du fait autochtone dans le monde, qui est au cœur du programme en études autochtones lancé en 2015 par la professeure Marie-Pierre Bousquet. Ce programme, administré par le Département d’anthropologie, vise autant à étudier l’autochtonie et les peuples autochtones partout dans le monde qu’à sensibiliser le public et les étudiants aux complexités qui s’attachent au mot « autochtone » dans le contexte de la déstabilisation et de la déterritorialisation qui semblent toucher le système mondial.
Le rapport des Euro-Canadiens avec les peuples autochtones du Nouveau Monde est complexe. Parfois alliés, parfois ennemis, quasiment toujours diabolisés, les membres des Premières nations ont été obligés de lutter contre la colonisation, la violence et les épidémies. On pense que le Nouveau Monde comptait jusqu’à 50 millions de personnes au moment de l’arrivée de Christophe Colomb en 1492. Aujourd’hui, il ne reste que 1,7 million d’Autochtones au Canada et 2,7 millions aux États-Unis. Le terme « Autochtone » est un concept occidental qui ignore les traits qui distinguent plus de 1000 groupes l’un de l’autre.
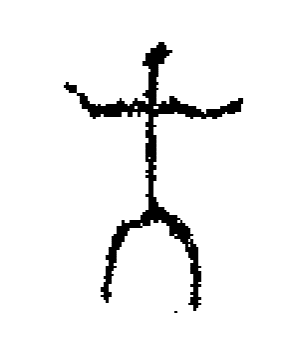
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce numéro, en particulier à Mathieu Boivin, doctorant, coordonnateur de stages et pilier du programme.
Comme toujours, on attend vos commentaires, et surtout on vous invite à partager vos histoires qui racontent comment vos études au département vous ont marqués (pour le prochain bulletin) (guy.lanoue@umontreal.ca).
Notre « petit bonhomme », symbole du département, est devenu un « Autochtone », car il vient de la région du Lac des Bois, une zone « autochtone », et il a 5000 ans (précolombien). Avant, il était tout bonnement un homme.
Volet recherche
Nous voulons avant tout présenter le côté humain de l’autochtonie. Ce sentiment d’appartenance est le sujet du programme en études autochtones, qui s’avère non seulement être la base d’un programme d’une grande institution universitaire, mais aussi un espace de l’imaginaire nord-américain où l’héritage autochtone se heurte à l’un des piliers incontournables de la vie universitaire : la recherche académique.
Traditionnellement, la recherche produit des savoirs qui s’insèrent dans une tradition d’origine européenne, humaniste et rationnelle. Ces traits ne sont pas présents dans la population en général, et encore moins dans les communautés autochtones, où le besoin d’isoler les savoirs formels de leur utilisation dans la vie quotidienne ne se faisait pas sentir.
Cet écart était jusqu’à récemment insurmontable, mais aujourd’hui plusieurs personnes autochtones travaillent dans le milieu académique. Il est aussi vrai que la sensibilité des chercheurs a évolué. Aujourd’hui, nous pensons que l’exploration et l’analyse d’une autre culture sont un projet collaboratif et pas une affirmation de la domination occidentale.
Femme satudene travaillant une peau d’original, vallée du Mackenzie, 1976. Photo : Guy Lanoue
Au département, plusieurs mènent des projets de recherche qui touchent des populations autochtones : Marie-Pierre Bousquet, Adrian Burke, Robert Crépeau, Christian Gates St-Pierre, Christina Halperin, Guy Lanoue, Brad Loewen et Luke Fleming ont tous travaillé avec des Premières nations, de l’Alaska au Mexique, de l’Ungava à l’Amazonie. Nous vous invitons à visiter leurs pages Web personnelles pour voir comment notre travail rejoint vos intérêts.
Barbara Diabo et les Buffalo Hat Singers, inauguration du programme en études autochtones, septembre 2015. Photo : Terry Randy Awashish.
L’histoire du programme en études autochtones de l’UdeM
Marie-Pierre Bousquet, directrice
Avril 2013 : sous l’impulsion du docteur Stanley Vollant, un shaputuan innu est installé devant le pavillon principal de l’Université de Montréal. S’ouvre alors la première Semaine de rencontres autochtones que le campus de l’Université ait connue. Je fais partie du comité organisateur depuis plusieurs mois déjà, et je me pose la question à savoir si le moment est venu de créer un programme en études autochtones dans mon institution. J’ai toujours eu envie qu’il y en ait un, mais j’attendais que quelqu’un d’autre le crée. Est-ce à moi de le faire? Je ne suis pas Autochtone, mais j’enseigne des cours en anthropologie sur les questions autochtones depuis mes débuts à l’Université. C’est décidé, je mets quelques idées par écrit.
Le jour de l’inauguration du shaputuan, je rencontre le recteur. Il me lance : « Alors, quand est-ce que vous allez créer un programme en études autochtones? » Justement, l’ébauche est prête sur mon ordinateur. Je réunis les professeurs des différentes disciplines qui donnent des cours sur des sujets liés aux Autochtones, je consulte mon réseau personnel de membres de Premières Nations et c’est parti. Mes étudiants de cycles supérieurs me soutiennent, me motivent, m’inspirent et me font des suggestions.
Taqralik Partridge et Nina Segalowitz, démonstration de chants de gorge au Café Satellite de l’Université de Montréal, Semaine Mitig 2015. Photo : Emanuelle Dufour.
« Il faut en plus un Salon des étudiants autochtones, Marie-Pierre, et que cette semaine de rencontres devienne un événement annuel! ». Elle le deviendra, sous le nom de Semaine Mitig. En anicinabemowin, mitig veut dire « arbre », symbolisant la croissance (des études autochtones, de la présence autochtone dans l’université, etc.) et l’enracinement.
Le projet prend de l’ampleur, mais je ne peux pas prendre tout cela en charge seule. « Nous sommes tellement en retard par rapport à d’autres universités! ». Je ne compte plus le nombre de fois où l’on m’a partagé cette réflexion. L’enthousiasme est là. Toutes les structures se mettent en place. Tant d’autres idées surgissent encore : créer des bourses pour les étudiants autochtones? Des professeurs et des donateurs privés ouvrent des fonds et je vais suivre en créant le prix Claude-Kistabish en 2016. « Et si on avait un toponyme autochtone sur le campus? ». Un jour, oui. Je n’ai plus l’impression d’être seule dans ce projet. Nous sommes nombreux : professeurs, étudiants, gestionnaires, tous unis par un même désir d’accueil et de décolonisation. Tant de choses ont changé à l’université depuis 2013. Contrairement à la fable, nous ne sommes pas la tortue partie à point, mais le lièvre parti dans les derniers, et qui a réussi à rejoindre le peloton!
Claude Kistabish, Abitibiwinni de Pikogan, étudiant en anthropologie, décédé en 2016. Le prix qui porte son nom est décerné aux étudiants autochtones ayant fait preuve de persévérance dans leurs études.
Mitshetuteuat - Ils sont plusieurs à marcher ensemble
Sortir chacun de ses ornières pour marcher ensemble sur le même chemin; le long parcours de l’Université vers une autochtonisation
Samuel Rainville, coordonnateur du Centre étudiant des Premiers Peuples, Services aux étudiants, UdeM
Caroline Gélinas, conseillère principale au cabinet du recteur pour les relations autochtones à l’UdeM1.
En 2015, lorsque la Commission de vérité et de réconciliation du Canada a publié son rapport en interpellant, parmi d’autres, les établissements d’enseignement postsecondaire, il semblait que le travail à faire était énorme. Les appels à l’action demandaient de créer des cours, d’intégrer des méthodes d’enseignement, d’établir un programme dédié de financement de la recherche et de « remédier à l’insuffisance des places disponibles pour les élèves des Premières Nations qui souhaitent poursuivre des études »2.
Rapidement, un groupe de travail est formé. On constate que, chacun de son côté, divers départements, des chercheurs et des groupes étudiants peinent depuis des années à faire avancer leurs projets. L’effort à faire était donc, en fait, de s’asseoir ensemble et de trouver les moyens de faire converger les initiatives vers un même projet plus vaste de décolonisation et d’autochtonisation de l’Université de Montréal.
Un poste de responsable de la liaison entre la population étudiante autochtone et l’Université de Montréal est créé. Aujourd’hui, le Centre étudiant des Premiers Peuples est directement rattaché aux Services aux étudiants (SAÉ). Des bourses sont créées pour encourager les étudiants autochtones à poursuivre leur parcours universitaire et récompenser leur persévérance et une première bourse est remise en 2019, à partir d’un fonds privé, pour un projet de recherche étudiant. L’Université de Montréal a aussi décerné trois doctorats honorifiques à de grands leaders autochtones — Nicole Nanatasis O’Bomsawin (2011), André Dudemaine (2017) et Michelle Audette (2018) —, reconnaissant leur contribution exceptionnelle à la société.
Murale de Jessical Sabogal, 2017 , White Supremacy Is Killing Me, Saint-Henri (Montréal) Photo prise lors de l’École d'été du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA), juin 2019
«Différentes initiatives étudiantes ont aussi été pérennisées. C’est le cas du Salon Uatik, situé au niveau mezzanine du pavillon 3200 Jean-Brillant, qui est un espace réservé aux étudiantes et étudiants autochtones. En plus d’être un lieu d’accueil, de rencontres, de détente et de travail, le Salon Uatik offre maintenant divers services visant à favoriser l’insertion et la réussite des étudiantes et étudiants autochtones. Il est désormais soutenu par les SAÉ.
La semaine Mitig est, quant à elle, devenue une tradition. Chaque année, en septembre, une panoplie d’activités faisant rayonner les Premiers Peuples sont offertes sur le cours d’une semaine. À l’automne 2019, les étudiantes et étudiants ont pu assister à des projections de courts (avec la participation de la Wapikoni Mobile) et de longs métrages, au concert en plein air de Matiu à la place Laurentienne, à des ateliers d’artisanat sur la terrasse du garage Louis-Colin (avec la participation du centre d’amitié Montréal Autochtone), à des expositions de livres et d’ouvrages autochtones (par les diverses bibliothèques du campus), etc. La programmation, bien chargée, a permis à l’Université de Montréal de renforcer ses liens avec la communauté autochtone montréalaise et aux étudiantes et étudiants autochtones et allochtones d’échanger.
Nicole O’Bomsawin, première personne autochtone à recevoir un doctorat honoris causa à l’Université de Montréal, en 2011, remis par le Département d’anthropologie. Photo : Université de Montréal
Terry Randy Awashish, Construire ensemble, source et informations supplémentaires : umontreal.ca/premierspeuples
C’est à l’automne 2019 que la première Cérémonie des réussites étudiantes autochtones a eu lieu. Organisée par les SAÉ et le Réseau des diplômés et des donateurs en partenariat avec la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, 14 étudiants autochtones sur 55 y ont participé, accompagnés de parents, d’amis et de membres de diverses communautés autochtones. La soirée a été créée sur mesure par et pour la communauté. Cette occasion a permis de rappeler que, pour les étudiantes et étudiants autochtones, la réussite peut prendre de nombreuses formes autres que l’excellence académique. Le groupe de travail et le comité-conseil Place aux Premiers Peuples ont publié un plan d’orientation visant une meilleure inclusion des peuples des Premières Nations et Inuit à l’Université3. On a voulu s’assurer de la présence durable auprès de la haute direction de considérations et d’engagements en matière d’orientations, de stratégies et d’initiatives dans le dossier de réconciliation et d’autochtonisation de l’Université. Dans ce contexte, en octobre 2019, Caroline Gélinas a été nommée au poste de conseillère principale aux relations autochtones au cabinet du Recteur. Elle sera appelée à soutenir la haute direction dans la mise en œuvre d’une vision articulée en matière d’activités promouvant la réconciliation et le vivre ensemble avec les Premiers Peuples. Elle travaillera en collaboration avec l’ensemble des facultés, vice-rectorats, départements et services afin de faciliter les orientations à mettre de l’avant, en plus d’opérationnaliser un plan stratégique pour faire de l’Université un milieu d’études et de travail plus diversifié et inclusif. Le rôle de représentation et de rayonnement de l’implication de l’Université auprès des communautés autochtones constitue également un volet important du mandat de Caroline Gélinas.
1 Merci à Luc Bernier, membre du Groupe de travail et du comité conseil Place aux Premiers Peuples à l’UdeM et du vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études de l’UdeM, pour sa contribution.
2 Commission de vérité et réconciliation du Canada, Appels à l’action (2015), § 11, 16, 62 et 65 (http://www.trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf) [accessed 15 January 2019].
3 Marie McAndrew et Anne Marchand, Orientations : Équité, diversité et inclusion - Place aux Premiers peuples (Montréal : Université de Montréal, 19 avril 2019), p. 12 (http://enjeux-universitaires.ca/NV/numeros/2018-19/no-73-16-avril-2019/eu73_r3.pdf).
Lire les littératures autochtones à l’université
Marie-Eve Bradette, candidate au doctorat en littérature comparée et coordonnatrice étudiante du CIÉRA-UdeM
Dans le cadre de ce numéro spécial du bulletin des diplômés en anthropologie consacré à la valorisation des études autochtones à l’Université de Montréal, j’ai été invitée, à titre de doctorante non pas en anthropologie, mais bien dans le domaine des études littéraires autochtones, à « me raconter » et à exposer mon parcours à l’Université de Montréal et la manière dont il est possible, au sein de l’institution, de faire résonner les voix autochtones. De même, à titre de coordonnatrice étudiante du Centre interuniversitaire de recherches et d’études autochtones pour l’Université, l’invitation concernait mon passage au centre de recherche, le travail, plus largement, de celui-ci. Dissidente, j’ai décidé de ne répondre qu’obliquement à cette invitation et surtout à sa formulation pour consacrer, plutôt, les quelques lignes qui m’étaient réservées à une brève réflexion au sujet des littératures autochtones, à ce que leur inclusion dans les corpus enseignés à l’université rendait possible. J’ai eu envie de parler de ce que la rencontre avec ces littératures ouvre quant à nos conceptions de ce « grand savoir » dont l’université se revendique comme étant la gardienne.
Dans sa préface à l’anthologie Nous sommes des histoires publiée en 2018, l’écrivain Wendat Louis-Karl Picard écrit que :
« Malgré la richesse et la diversité des œuvres publiées au cours des quarante dernières années, avec une accélération notable de la production au XXIe siècle, la littérature autochtone a toujours bien peu de place dans les cours de français au Québec, quel que soit le niveau d’enseignement. Les recherches universitaires sur le sujet demeurent timides, bien que, a contrario, on puisse s’étonner du nombre d’étudiants qui choisissent malgré tout, sous la recommandation de pionniers ou par esprit d’aventure devant un territoire résistant à l’arpentage, de s’y intéresser dans le cadre de leurs recherches. (p. 6) »
J’aime à penser que ce constat sur la place de l’enseignement des littératures autochtones au sein des départements francophones s’il est encore d’une grande actualité, tend à changer, notamment avec la création du premier programme d’études supérieures spécialisées dans l’étude des littératures et des médias autochtones dans la francophonie qui, s’il trouve un ancrage dans le Département de littératures et de langues du monde, fait appel à une approche
pluridisciplinaire des études autochtones; à penser que les littératures autochtones trouveront une place de plus en plus grande au sein des corpus littéraires enseignés et, qui plus est, en tant que corpus à part entière, puis que ces textes ouvriront un dialogue nécessaire au sujet de la décolonisation de nos institutions d’enseignement supérieur. Plus encore que les textes littéraires d’auteurs et d’autrices autochtones seront pris au sérieux dans la manière qu’ils ont de proposer des visions alternatives non seulement des savoirs, mais aussi de la manière dont on accède à ceux-ci.
Les savoirs autochtones sont, en effet, multiples et répondent à des conditions d’émergence différentes des savoirs produits dans un contexte universitaire, c’est ce que met de l’avant l’intellectuelle Nishnaabeg Leanne Betasamosake Simpson dans son chapitre « Land as Pedagogy » (As We Have Always Done, 2018). Elle souligne, par exemple, l’absence du consentement des étudiantes et étudiants dans la structure verticale de la transmission des savoirs à l’université et elle en appelle à une revitalisation de la conception du « territoire comme pédagogie », d’un apprentissage non pas sur le terrain, mais d’un enseignement en relation consensuelle et réciproque avec le territoire.
Pour ma part, je réitère la conception de Lee Maracle des récits, et donc des littératures, comme théories (Memory Serves, 2015). Mais aussi, je crois que les littératures au travers de la mise en branle d’une imagination narrative et poétique peuvent faire advenir un territoire comme lieu de savoirs alternatifs. De plus, ce que mes recherches dans le domaine des études littéraires autochtones à l’Université de Montréal m’auront appris, fondamentalement, c’est que les littératures autochtones sont une lentille critique depuis laquelle il est possible de repenser les disciplines d’études dans lesquelles nous engageons, qu’elles sont des truchements vers des connaissances ressenties (Million, 2009) corporéïsées et relationnelles trop souvent mises de côté dans les contextes académiques.
Ainsi, faire une place aux voix autochtones à l’université, c’est aussi faire une place aux littératures qui sont les manifestations puissantes des savoirs, des cultures, des langues et des identités autochtones. Enfin, pour citer, encore une fois Louis-Karl Picard Sioui : « de plus en plus décomplexée, la littérature autochtone nous attend, sans cesse, ailleurs » (2018, p. 6).
Soutenir les études autochtones d’une bibliothèque universitaire
Catherine Fortier (diplômée du Département d’anthropologie de l’Université de Montréal, 2001)
Bibliothécaire en anthropologie, études autochtones, sociologie et études féministes, des genres et des sexualités
Bibliothèque des lettres et sciences humaines
Université de Montréal
Lorsque j’ai terminé mon baccalauréat spécialisé en anthropologie, je souhaitais poursuivre mes études aux cycles supérieurs dans un domaine qui serait complémentaire à ma formation en sciences sociales. Je voulais également apporter un aspect pratique et professionnel à mon cursus universitaire. C’est également à ce moment-là que j’ai fait le souhait de pouvoir continuer à œuvrer dans le milieu universitaire. J’ai donc obtenu une maitrise en sciences de l’information à l’École de bibliothéconomie de l’Université de Montréal. Après un bref passage à l’UQAM, j’ai obtenu le poste que j’occupe actuellement, soit celui de bibliothécaire disciplinaire. Mon vœu s’est donc réalisé; l’Université de Montréal est ma deuxième maison depuis bientôt 22 ans.
Dans le cadre de mon travail, mon rôle est de soutenir l’enseignement et la recherche par le biais d’activités telles que la formation aux outils documentaires, l’achat de la documentation, l’aide à la recherche et le soutien aux chercheurs et professeurs des disciplines dont j’ai la responsabilité. De plus, chaque bibliothécaire disciplinaire pourra au cours de sa carrière développer certains intérêts plus spécifiques envers des enjeux particuliers des sciences de l’information. Dans mon cas, je crois que mon intérêt pour les études autochtones s’est manifesté lors de mes études de premier cycle. En effet, bien que je sois bibliothécaire, je me considère avant tout anthropologue.
Dans le milieu des bibliothèques universitaires, plusieurs initiatives sont actuellement en place afin de soutenir adéquatement les étudiants et professeurs autochtones. On remarque que les bibliothèques du centre et de l’ouest du Canada sont à l’avant-garde; certains spécialistes parlent même de 25 ans d’avance sur le Québec. Malgré ce constat, le personnel et les bibliothèques de l’Université de Montréal participent et mettent sur pied divers projets d’autochtonisation.
Volet documentaire des Mini-Écoles de la Santé
Depuis plusieurs années, nous contribuons aux Mini-Écoles de la Santé de l’Université de Montréal. Ces Mini-Écoles sont une initiative du docteur Stanley Vollant, premier chirurgien innu du Québec. En 2013, ma collègue Monique Clar, bibliothécaire à la Bibliothèque de la santé, rencontre le docteur Vollant et lui propose d’ajouter un volet documentaire à la Mini-École. Des livres sur la santé, les sciences et les métiers sont sélectionnés par les responsables des bibliothèques scolaires des communautés attikameks et innues visitées et la bibliothécaire. Ces ouvrages sont présentés aux enfants durant les activités de la Mini-École et sont ensuite offerts à la bibliothèque de l’école. Depuis, la tradition se poursuit. Lors de chaque Mini-École, un bibliothécaire, un technicien en documentation ou un étudiant en bibliothéconomie et sciences de l’information accompagne le groupe d’étudiants en médecine, afin de faire la promotion des ouvrages donnés par la Direction des bibliothèques de l’Université de Montréal. Lors de la dernière Mini-École, qui a eu lieu en décembre dernier, j’ai eu la chance de présenter les livres aux enfants de l’École Primaire Simon P.-Ottawa de Manawan.
Développement des collections
Les bibliothécaires de toutes les bibliothèques de l’Université de Montréal portent une attention particulière au développement des collections afin d’encourager la production intellectuelle d’auteurs et de maisons d’éditions autochtones. L’an dernier, lors de la Semaine autochtone Mitig, plusieurs bibliothèques du réseau ont participé à la mise en valeur d’ouvrages issus de leurs collections lors d’une exposition thématique.
Guides de recherche
Plusieurs guides de recherche sont également offerts sur le site Web de la Direction des bibliothèques : Études autochtones, Santé autochtone et Éducation, des enjeux et perspectives autochtones. Ces outils proposent diverses ressources documentaires choisies et suggérées par les bibliothécaires de l’Université de Montréal et sont un excellent point de départ si l’on s’intéresse à la documentation relative aux études autochtones.
Rencontres et initiatives autochtones en bibliothèque
L’an dernier, un comité de membres du personnel de la Direction des bibliothèques a proposé d’organiser une activité sur le thème de l’autochtonisation de nos bibliothèques. Le projet a été retenu, et à la suite des diverses discussions du comité, il a finalement été décidé de proposer deux activités à tout le personnel des bibliothèques de l’Université de Montréal. Ces activités s’inscrivent dans le cadre des recommandations du Comité de vérité et réconciliation de la Fédération canadienne des associations de bibliothèques (FCAB) pour la mise en œuvre d’initiatives qui appuient les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.
Les objectifs de la première activité, qui a eu lieu au printemps 2019, étaient de sensibiliser le personnel des bibliothèques aux réalités des autochtones du Canada, de connaître les besoins des étudiants et des chercheurs autochtones de l’Université de Montréal, ainsi que de définir les liens à créer entre autochtones et allochtones.
La seconde activité, prévue au printemps prochain, présentera au personnel différentes initiatives de mise en valeur du patrimoine autochtone par des bibliothèques universitaires ou nationales au Canada. Nous aborderons également certains enjeux liés à la décolonisation des bibliothèques universitaires.
Programme à l’intention des étudiantes et étudiants autochtones en bibliothéconomie
L’Université Concordia collabore avec l’Université McGill et l’Université de Montréal à un programme de stage à l’intention des étudiantes et étudiants autochtones. Dans le cadre de ce programme, une étudiante ou étudiant des Premiers Peuples inscrit à l’Université McGill ou à l’Université de Montréal à la maitrise en bibliothéconomie et sciences de l’information se voit offrir un stage rémunéré à la Bibliothèque Vanier de l’Université Concordia. L’université d’accueil prend en charge les frais de scolarité.
Soutien documentaire au Salon Uatik
Un projet de soutien documentaire pour les étudiantes et étudiants qui fréquentent le Salon Uatik verra certainement le jour prochainement. Samuel Rainville, coordonnateur du soutien à la communauté étudiante autochtone, et moi souhaitons offrir un service d’aide à la recherche qui répondra à leurs besoins spécifiques.
Les bibliothèques et leur personnel sont des acteurs et partenaires importants au sein des études autochtones de l’Université de Montréal. Plusieurs initiatives collaboratives ont déjà été mises en place et d’autres viendront bonifier l’offre actuelle dans les années à venir.
« Je me sens parfois comme mes grands-parents et mes parents... »
Yvette Mollen, enseignante de langue innue (innu aimun)
Je suis qui je suis, parce qu’un jour j’ai pris la décision de devenir, c’est-à-dire de vivre.
Je suis née à Havre-Saint-Pierre, en aval d’Ekuanitshit. La route ne s’y rendait pas encore, il fallait prendre le bateau. Ma sœur aînée était née sous la tente et cela s’était compliqué, voilà pourquoi ma mère avait choisi l’hôpital pour me donner naissance.
J’ai habité chez mes parents, à Ekuanitshit, jusqu’au départ pour les études à l’extérieur de la réserve.
À quatorze ans, je savais déjà que j’allais partir un jour de cet endroit qui était, pour moi, devenu sombre, mais que j’aimais tant après tout. Je savais que j’irais là-bas, où il y a des bibliothèques et des livres. Lire était une passion qui me faisait oublier les noirceurs de la vie, les misères de l’enfance et les malheurs de la réserve. En lisant, j’apprenais!
J’ai grandi trop vite, j’ai vieilli trop rapidement, sans vraiment me rendre compte que j’étais une enfant. À neuf ans, je voulais déjà entrer dans le monde des esprits. Aller là où les humains normaux ne veulent pas aller avant d’être vieux ou d’être au bout de leur vie. Partir, pour moi, c’était probablement une façon de sortir de cette enfance qui n’en était pas une vraie. J’avais compris que je devais protéger ce qu’il me restait encore, mon intelligence, mon intégrité d’enfant, mon aptitude à apprendre. Voilà pourquoi je devais partir.
Je suis née entre deux époques : l’époque des gens nomades et l’époque de ceux qui sont devenus sédentaires. Mes grands-parents étaient des nomades qui ont parcouru des kilomètres et des kilomètres de territoire, qui ont traversé des lacs, des rivières, des rapides et fait des portages. Ils ont chassé le caribou, ils ont vécu à cette époque formidable. Mon père et ma mère ont aussi fréquenté l’intérieur des terres avec nous, les enfants, parmi les bagages. Nous étions nomades et nous le restons toujours un peu. Ekuanitshit est devenue officiellement une terre réservée, c’est-à-dire une réserve fédérale, le 30 avril 1963, deux ans avant ma naissance. Les Innus sont devenus peu à peu sédentaires.
Mon père, aujourd’hui âgé de 84 ans, était un grand chasseur qui avait appris de son père, comme cela se faisait de génération en génération. Il a transmis des connaissances, à son tour, à ma mère qui n’avait pas pu tout apprendre de ses parents, puisqu’elle avait été pensionnaire. Comme plusieurs enfants de sa génération, ma mère avait fréquenté le pensionnat, elle y avait beaucoup appris disait-elle. Quand elle retournait dans la communauté durant l’été, elle apprenait de sa mère et de son père, elle parlait innu avec eux et elle le parlait très bien.
Mon père, lui, n’a pas fréquenté ce genre d’écoles : il a fréquenté l’école de ses parents, il a parcouru le territoire immense de son père pour sa survie et celle de sa famille. Il nous a aussi transmis ses connaissances. C’est lui qui m’a appris à faire de la bannique et il a été mon dictionnaire vivant jusqu’à tout récemment.
Mathieu Mestokosho (photo de Gerry McNulty)
Ce sont eux, mes parents, qui m’ont inspiré ma passion pour la langue innue. Mes grands-parents paternels et maternels parlaient aussi très bien l’innu, avec l’intelligence des Innus qui ont fréquenté l’intérieur des terres : ils parlaient la langue du territoire. J’ai entendu ma grand-mère paternelle raconter des histoires de son enfance, elle racontait ses souvenirs. J’ai entendu mon grand-père maternel parler de ses histoires de chasse. Quand j’arrivais chez lui, il était assis sur sa chaise berçante; sur la chaise voisine, ma grand-mère, sa plus fidèle auditrice. J’écoutais, même si je ne comprenais pas toujours très bien toute la portée de ses histoires. C’est seulement plus tard que j’ai pris connaissance, avec beaucoup d’intérêt, de ses récits de chasse.
Je savais donc déjà que j’allais quitter Ekuanitshit… Le secondaire terminé, je pars à l’aventure pour le cégep et pour l’université. J’ai, dans mes bagages, ma culture et ma langue maternelle. J’arrive en ville et j’ai une vision de ma communauté, un regard nouvellement extérieur qui me donne presque un choc. Je constate, je me désole, mais je ne peux abandonner l’idée que je vais retourner vivre dans ma communauté un jour, un jour où j’aurai en poche mes papiers attestant que je suis diplômée de quelque chose. La ville me fait connaître mon village. Je me sens seule parfois dans cette grosse ville, je suis une étrangère.
Je persévère, je découvre. Il faut dire que j’avais déjà entendu parler de la « grande école », mishta-katshishkutamatsheutshuap. Plusieurs universitaires avaient séjourné chez mes parents et avaient parlé, en long et en large, de cette école : la recherche, les questions, les connaissances. Des hommes et des femmes qui s’intéressaient à l’humain, à la chasse, à la langue, à la vie en société innue, aux animaux, aux plantes et j’en passe. D’autres étaient venus avant eux et avaient transmis leur vision de nous : leur vision fragmentaire qui va se transmettre dans les maisons d’enseignement et universités, de génération en génération, il faut croire. Parfois, leur travail a été bénéfique pour nous, cela nous a fait connaître et d’autres fois, ce n’était pas fameux… Il est arrivé que nous n’ayons jamais revu ces personnes ni leurs travaux. Ma mère était une « professeure émérite » assistée par mon père, sa principale référence.
Après mes études, je suis revenue à Ekuanitshit pour travailler à l’école, pour enseigner le français, mais le directeur me parle de la langue innue. Ma mère sera ma professeure de langue innue : écriture et lecture. Je retombe en amour avec ma langue maternelle. J’en apprends la structure et je la transmets aux enfants de la première année jusqu’au secondaire. C’est merveilleux de connaître, de transmettre et d’apprendre, surtout aidée par ma maman. .
Ma fille aînée est née trois mois après la fin de mon baccalauréat. Ma deuxième, quatre ans plus tard. Elles ont grandi. À l’âge adulte, chacune a fait de moi une ukumimau comblée d’amour. Je transmets aujourd’hui ma connaissance de la langue à mes deux petites-filles, qui parlent beaucoup plus le français et l’anglais que l’innu. Elles auront une connaissance de leur langue maternelle, car les mamans parlent encore la langue innue et c’est merveilleux.
Après avoir enseigné à l’école d’Ekuanitshit, j’ai travaillé pendant 13 ans à l’ICEM (Institut culturel et éducatif montagnais), aujourd’hui l’Institut Tshakapesh. J’y ai dirigé le secteur langue, et ensuite le secteur culture s’est ajouté. Beaucoup de travail a été fait là pour assurer une grande place à la langue innue, c’est-à-dire qu’elle soit vue, lue et entendue, dans les livres ou sur le Web : dictionnaires, grammaires, programmes, et j’en passe.
Depuis maintenant presque trois ans, j’enseigne au Centre de langues de l’Université de Montréal, à l’Université du Québec à Chicoutimi, à Montréal Autochtone et ailleurs. Je suis redevenue nomade, car je voyage beaucoup d’un endroit à l’autre, j’enseigne à des Innus (locuteurs et non-locuteurs) et à des allochtones. Je transmets ma langue maternelle pour favoriser sa pérennité. Je me sens parfois comme mes grands-parents et mes parents, qui parcouraient le territoire pour leur survie, mais aussi pour la vie. Je me sens comme eux en essayant de sauvegarder ma langue innue.
Je vous présente ici ma famille : mon papa Raphaël Mollen et mes grands-parents paternels Sylvestre Mollen et Marguerite Napish; ma défunte maman Desneiges Mestokosho et mes grands-parents maternels, Mathieu Mestokosho et Marie-Madeleine Nolin. Mes deux filles : Gaëlle et ma petite-fille Aurélia, Laura-Kim et ma petite-fille Camila-Joy.
Appels et nouvelles
Dans le dernier numéro du bulletin (nº 4), nous vous avions invité à partager vos témoignages au sujet de la planète menacée. Nous avons changé le nom de cette chronique : SOS Planète est devenu Revue verte. On relance notre requête : svp, partagez vos histoires avec nous et avec le monde.
Nous tentons aussi de reconstituer nos archives photographiques. Si vous avez des photos qui illustrent votre monde anthropologique (voyages, recherche, nostalgie pour votre vie étudiante), nous voudrions les mettre en ligne sur notre site. On attend vos contributions!
Comme toujours, nous vous invitons à jeter un coup d’œil à notre site Web.
Si vous voulez avoir des nouvelles de nos activités, vous y trouverez nos bulletins hebdomadaires et les 4 premiers numéros du bulletin des diplômés.
Visitez Campagne pour les panneaux solaires dans un village guatémaltèque pour nous aider à acheter des panneaux solaires pour ce village, où travaillent la professeure Christina Halperin et ses étudiantes et étudiants.
Piège tanana (Dene) pour saumon, fleuve Tanana, Alaska (Photo : Guy Lanoue, 2019)