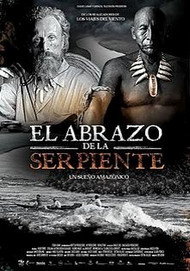La vie avec la COVID-19 - Automne 2020
Le mot du directeur
Guy Lanoue
Nous vivons actuellement une période unique, et nous profitons de ce numéro pour transmettre notre solidarité à tous et à toutes. Il peut être difficile de trouver le côté positif de ce que nous vivons, mais au moins notre communauté immédiate au département ne semble pas avoir encouru de pertes, bien que quelques personnes aient été déclarées positives à la Covid-19. Heureusement, tout le monde a affronté la menace avec succès.
Dans ce bulletin, les personnes témoignent des enjeux et difficultés rencontrées : les recherches suspendues, les voyages annulés, les écoles fermées aux enfants, la problématique psychique causée par la perte de contact avec les gens dans les salles de cours, dans les laboratoires et même dans nos couloirs.
Nous avons fait appel à une discipline sœur (communication, avec le témoignage de Richard Leclerc) pour savoir comment les défis de la distance étaient abordés ailleurs.
En dépit de tout, nous avons aussi de bonnes nouvelles : nous avons fêté (virtuellement!) les 50 ans de Bernard Bernier, un pilier du département. Une occasion de bonheur…
Nous avons également eu la permission de transformer une grande salle de conférence, le Carrefour, qui accommode normalement 150 personnes, en laboratoire temporaire pouvant recevoir 35 étudiants et étudiantes.
Les laboratoires ont forcément toujours lieu en présentiel (mot haïssable, mais utile), sinon nos cours en archéologie et en bioanthropologie n’auraient pas beaucoup de sens.
Nous avons donc converti une grande salle de conférence d’une capacité habituelle d’au moins 100 personnes en laboratoire temporaire. Ceci nous permet d’accommoder des séances avec 35 étudiants et étudiantes à la fois. Nos laboratoires habituels, qui peuvent normalement en accueillir 20, en hébergent seulement 5 avec les consignes sanitaires.
 |
Nous sommes toutes et tous conscients que parler de l’enseignement à distance ne fait pas justice à l’ampleur du problème. Nous ne sommes pas des citernes pleine de connaissances qu’on fait écouler en ouvrant le robinet 3 h/semaine dans une salle de cours.
Pour une discipline comme l’anthropologie qui cible l’humain, l’enseignement à distance ne peut être la seule solution, et c’est pourquoi nous avons maintenu des activités en laboratoire.
Ce n’est pas surprenant que les personnes essaient de retourner au département quasi subrepticement (mais avec motivation!) : il y a des laboratoires à préparer pour la centaine d’étudiants et d’étudiantes qui nous visitent chaque semaine, pour lesquels l’expérience en laboratoire ou en atelier est une partie fondamentale de leur formation.
Il faut prendre le courrier (il y en a toujours, même dans cette époque électronique), arroser les plantes, poser des flèches pour canaliser la circulation, s’assurer que les salles ont du désinfectant et des gants pour tout le monde, et ainsi de suite.
Je remercie en particulier notre équipe ad hoc qui a fait des efforts extraordinaires cet été pour mettre en place un département fonctionnel, même s’il est temporairement un peu triste : Isabelle Cagiotti, Katherine Cook, Violaine Debailleul, Jean-Christophe Ouellet, Claire St-Germain, et j’en passe. Tout le monde a participé! Un grand merci à Amal Haroun et à nos contributeurs et contributrices à ce numéro. Prenez soin de vous!
On vous invite comme d’habitude à partager vos histoires et photos. Communiquez avec nous à : anthro@umontreal.ca. |
Du terrain au confinement : ça va bien aller, ou presque…
Anthony Grégoire, doctorant en anthropologie/ethnomusicologie, Université de Montréal et EHESS (Paris)
Le lundi 13 janvier 2020, lors de mon 303e jour sur le terrain, un 1er cas d’infection au coronavirus est déclaré hors du territoire de la Chine continentale. Aucune mention à ce sujet ne se retrouve dans mon carnet de terrain. Je suis épuisé : la cadence sur le terrain, la production d’un documentaire et le lancement d’un album à venir grugent les bribes d’énergie qu’il me reste.
Je ne crois pas avoir entendu ou lu quoi que ce soit sur la COVID-19 avant cette date, mais ça se répand de plus en plus. Des gens meurent alors qu’ici, dans mon désert sénégalais, je suis encore en sécurité, avec ma blonde et notre fils Théo, 2 ans et ½.
Pris entre le terrain, la fatigue et la désinformation – les fake news –, je constate que ça ressemble à une grosse grippe pour laquelle on n’a pas de traitement. La seule chose dont je parle, c’est de ce scénario catastrophe aux allures apocalyptiques : « Ce n’est pas la grippe qui fait peur; imaginez un peu que ça nous change tous et toutes en zombies ! » Je rigole. On rigole tous et toutes. Mais à l’international, les gens rigolent moins.
À partir de là et jusqu’au 28 février, je suis maintenant seul, et c’est le dernier droit avant mon retour à la maison. Une année complète sur le terrain est passée. J’ai hâte de revoir mon monde, mes parents, mes amies et amis, mes collègues, ma blonde et mon p’tit bonhomme qui attendent mon retour à moi aussi. J’ai les blues de ma culture alors que je deviens « spécialiste » d’une autre qui, elle, est déjà en train de disparaître. Le décalage est tellement grand…
C’est un schisme : l’Occident brûle alors que nous, rien ne nous atteint. On n’est tellement pas là! La vie est belle, on est peinards et peinardes au pays de la Teranga.
Mais les semaines deviennent des jours, qui se changent en minutes : le 28 février, je m’envole vers Montréal. J’ai le sentiment d’avoir accompli beaucoup de grandes choses! J’ai l’impression que plus rien ne m’arrêtera : ma thèse, je vais la clancher parce que je suis à fond dans mon truc et que j’ai compris pourquoi je devais lui donner la forme que je lui ai réservée. Je n’avais pas prévu que chaque masque que j’allais croiser sur ma route jusqu’à la maison m’éloignerait de cette idée…
Je retrouve mon fils et ma blonde qui sont venus me chercher à l’aéroport : je suis de retour ! On sous-loue un petit 3 ½ dans Rosemont–Petite-Patrie en attendant de trouver quelque chose de plus grand; de toute manière, nous sommes des gens actifs qui font du plein air, jamais à l’intérieur! On visitera la famille qu’on n’a pas vue depuis plus de 1 an… Bref, ça va passer vite !
C’est la relâche à l’Université. Pas d’Internet à la maison. C’est bien ! Je déconnecte pour mieux reconnecter avec mon milieu à moi. On prévoit partir pour voir nos familles, de grandes retrouvailles! Mais ça ne va plus…
À peine rentré que les 1ers ministres sonnent l’état d’urgence : « Restez à la maison. » À peine eu le temps de revoir le laboratoire au Département d’anthropologie que l’Université ferme. Je me rends à la garderie pour aller chercher mon fils. À la blague, je lui dis : « On va se renfermer, papa et fiston ! » Mais ce n’était pas une blague…
Ma blonde, qui a désormais un poste dans les services essentiels, n’est pas avec nous. On nous interdit littéralement de prendre la route : adieu, les retrouvailles joyeuses avec la famille ! Une semaine… puis 2… Et ça continue. On en est maintenant à 5 semaines en confinement. « Ça va bien aller », qu’on peut lire partout. Eh bien…
J’écris ces lignes et je me fais rigoler… Choc du retour? Rétro-choc? Appelez-ça comme vous voudrez, ce n’est pas ça! Par contre, non, ça ne va pas! Vous imaginez, vivre à toute vitesse, sur le terrain, 17 heures par jours, 7 jours par semaine, pendant toute une année? Vous imaginez ce sentiment enivrant d’épanouissement personnel et professionnel qui vous confirme que vous êtes à votre place, sur le terrain? Ce genre de sentiment qui vous donne une énergie que vous n’espèreriez même pas demander ni imaginer pouvoir avoir un jour. Ce sentiment qui vous fait vivre pour ce que vous êtes : un anthropologue de terrain! Mais imaginez revenir d’une telle année et qu’on vous dise dès votre retour que vous allez être confiné dans un logement sans pièce fermée pendant une durée indéterminée?
Ça, c’est ma détresse à moi. Elle m’appartient. Je suis là, en santé, et personne dans mon entourage n’a le covid-19. Mais je me sens attaché, étouffé. Je suis là, à la maison, tous les jours, à dessiner et à me rouler par terre, à chatouiller mon p’tit Théo que j’aime plus que tout au monde. Mais je ne me développe pas. Je souris. Mais je ne suis pas heureux. C’est terrible de pouvoir être aussi fier d’être papa et de pouvoir être un témoin aussi privilégié du développement formidable de son fils, mais de ne pas être le genre de personne qui puisse s’épanouir personnellement de ce genre de situation. « Profite des moments avec ton fils », me disent certain(e)s. « Tu dois tellement trouver ça magique d’avoir autant de plaisir avec ton p’tit bonhomme », m’envient d’autres. « Ça va bien aller »…
Non, ça ne va pas. Je suis carriériste, certes. Probablement plus que la moyenne. Et du jour au lendemain, on me dit que tous mes projets et mes recherches sont suspendus parce que la vie arrête. La planète arrête de tourner, effectivement. Mais moi, je suis là, à la maison, à continuer à vivre. Le temps est long. Mes discussions sont passées d’un extrême à l’autre : des mécanismes de vicariance identitaire et de transmutation symbolique dans la construction du répertoire musical à « pipi-caca-Spiderman »! Ha ha! C’est drôle! Mais c’est triste. Je pourrais travailler pendant l’heure de la sieste, mais le ménage, la vaisselle, la douche et la cuisine m’attendent au tournant… La thèse, on n’en parle même plus…
Mais je vais bien! J’ai la chance d’être, pourrait-on dire, à la tête de la pyramide du White privilege. J’ai ma blonde que j’aime, un fils en santé que nous aimons, un véhicule, un logement, et ma blonde perçoit toujours son salaire. On mange bien (parce que j’ai amplement le temps de cuisiner! Ha ha!). Ce n’est malheureusement pas le cas de mes supers copains, que j’ai laissés derrière moi, sur le terrain, dans un pays où la dépense quotidienne est de 3 000 francs CFA par ménage (environ 6$ CAN), alors que le revenu moyen est de 1$. Pour eux, le combat du quotidien est devenu une guerre. Comment faire pour nourrir sa famille, voir deux, trois ou quatre lorsqu’on est musulman? Comment se prévaloir d’une aide financière quand plus de 90% des emplois sont informels? De toute façon, comment faire dans un pays où l’État n’a pas mis en place de structure pour aider ses gens…? « Ici, on a de la chance », qu’on pourrait dire…
Ça aussi, c’est de la détresse. Mais ce n’est pas la mienne, bien qu’elle m’affecte puisqu’il s’agit de celle de mes amies et amis proches.
Dans mon cas, on pourrait parler de la COVID-19 d’un terrain à l’autre, d’une détresse à l’autre… Mais tout un chacun a sa détresse. Tout le monde est affecté par la situation. Je lisais le témoignage d’une psychologue sur Facebook ce matin – merci à mes données de téléphone de me garder le moindrement connecté –, qui disait que c’est bien mignon la phrase « ça va bien aller », mais que, dans le fond, c’est un peu innocent et naïf.
Les gens vivent quelque chose d’intense, de difficile. Et certaines personnes se prennent le mur en pleine gueule. Moi, j’ai l’impression qu’il s’agit plutôt d’une locomotive lancée à toute vitesse que le surplus de charbon finira bientôt de rougir…
Ça fait mal, et on n’en parle pas assez. On est toutes et tous trop occupés à discuter des familles touchées par la COVID-19 et à mettre des arcs-en-ciel dans nos fenêtres pour parler de celles et ceux qui vivent une détresse qui, elle, n’a pas grand-chose à voir avec le fait d’être malade ou non.
Elle est peut-être là, la conclusion à mon « témoignage » : l’isolement, la détresse, le sentiment d’échec et autres ne sont pas l’apanage de la crise actuelle. Le sourire des uns peut cacher quelque chose de plus profond, alors que la tristesse des autres peut nous laisser complètement dans l’indifférence. Certaines et certains sont touchés directement, d’autres seront des dommages collatéraux… Mais tout dommage a son poids et son prix.
Arcs-en-ciel et licornes... Occupez-vous plutôt de vos proches en tout temps. Ils peuvent vivre de la détresse, sous toutes les formes que ce soit. Superhéros, malfrats et incognitos, personne n’est mieux placé que l’autre. Tout le monde vit différemment une situation. Riches, pauvres et zen, tout le monde a les moyens d’aider quelqu’un qui en a besoin. Il suffit de se poser la question.
Je suis là à regarder les rayons du soleil. Je vais bien, et je n’ai jamais vécu une telle détresse. Je suis une sorte d’hyperactif, mais posé. Peu de trucs m’affectent, et je ne connais pas trop le stress, même si je connais le poids immense que peut exercer la pression sur mes épaules. Mais une détresse comme celle-là, je ne connais pas, et c’est difficile. Ça va bien aller ? Non. Mais on va s’en sortir, à condition de s’en parler.
Le confinement d’une maman doctorante
Marie Fally, doctorante en anthropologie
J’avais amorcé mon terrain ethnographique auprès des mères réfugiées quelques semaines avant que cette crise ne commence. Observations et entrevues allaient bon train, et même si le jonglage études/famille était un perpétuel défi, j’y avais trouvé une certaine forme de confort, voire de satisfaction.
Mais, depuis le 13 mars, ce confort s’est retrouvé bien malmené. Un isolement que nous comprenons et que nous respectons tant que faire se peut. Mais force est de constater qu’il est laborieux.
Il est laborieux du fait que, oui, je suis doctorante en anthropologie, mais je suis aussi maman de 2 enfants de 3 et 5 ans, vraiment, VRAIMENT pleins d’énergie.
Il est laborieux du fait que l’emploi de mon conjoint est considéré comme essentiel, qu’il ne peut s’effectuer en télétravail et qu’il demande parfois des horaires nocturnes.
Il est laborieux du fait que nous faisons partie de ces milliers d’expatriées et d’expatriés français dans la Belle Province et qu’au quotidien nous savons nos familles, amies et amis dans des zones « à risque ».
Il est laborieux du fait que, tels des milliers de Montréalais et Montréalaises, nous vivons dans un immeuble aux cloisons épaisses comme du papier à cigarette.
Il est laborieux du fait que nous sommes sans arrêt en train de nous inquiéter pour nos 2 voisins immunosupprimés, à grand risque.
Bref, ce quotidien est aussi exceptionnel que difficile. Mais, après quelques semaines de confinement, et malgré cette frustration planante causée par le manque de productivité scolaire et par les indéfinis délais supplémentaires que je requiers auprès de mes collègues si compréhensifs et compréhensives, j’atteins un degré émotionnel assez inattendu de mindfulness, qui me permet de réceptionner des petites nouvelles comme de grandes victoires.
Ma répondante « F04 » veut me répondre sur WhatsApp. C’est imparfait, possiblement problématique, mais c’est une bonne nouvelle. Mon fils arrive à écrire toutes les lettres de l’alphabet, c’est une jolie victoire.
J’ai croisé une amie hier – à plus de 2 m, bien sûr –, c’est un plaisir inestimable. Ma répondante « F01 » me donne ses impressions sur la situation, c’est bénéfique dans ma recherche. Ma fille a fait la sieste mercredi, c’est un succès sans nom. Il y a des petites fleurs sur l’arbre en bas de ma fenêtre, c’est une nouvelle réjouissante.
Bref, mon âme de maman, doctorante et expatriée, trouve dans le marasme de nouvelles peu gaies que l’on entend tous les jours un moyen de revenir à l’appréciation simple des choses que l’on oublie d’habitude, trop pris avec nos courses aux publications et nos renouvellements de visas ou inscriptions à l’école.
Alors, même si le quotidien est d’une fatigue indescriptible, qu’il est difficile d’expliquer à nos petits et petites qu’ils ne verront pas leurs amis et amies pendant encore quelque temps, que la silhouette de nos vacances à l’étranger s’efface peu à peu pour laisser place à des vacances à Montréal, il faut garder le sourire, être reconnaissants et reconnaissantes de ces petites victoires du quotidien, et prendre chaque jour comme une occasion de briller.
Really, it will be okay!
L’École de fouilles (Québec)
Christian Gates St-Pierre, Professeur adjoint au Département d’anthropologie
Depuis 1977, le Département d’anthropologie de l’Université de Montréal mène chaque année l’École de fouilles en archéologie préhistorique. Depuis 3 ans, cette dernière se déroule sur le site Isings, un village iroquoien du début du XIVe siècle situé à Saint-Anicet, dans le sud-ouest de la Montérégie.
Cette école intensive de 1 mois permet à un groupe de 10 stagiaires de se familiariser avec les méthodes et techniques de fouille archéologique, tout en participant à un projet de recherche scientifique portant sur le développement de l’agriculture et de la sédentarité chez les populations autochtones.
Une école de fouilles nécessite par définition une présence sur place : malgré les progrès technologiques de notre époque, rien ne remplace encore l’expérience du travail en équipe sur un véritable site archéologique.
Or, la promiscuité qu’entraîne une telle situation, tant sur le site archéologique lui-même qu’à la maison où nous hébergeons, n’aurait pas permis de mettre en place les mesures de distanciation physique exigées par les autorités de la santé publique. Il nous a donc fallu annuler l’École de fouilles pour cette année, à notre plus grand regret.
Les conséquences sont nombreuses pour les étudiants et étudiantes, car plusieurs ont ainsi perdu la chance de participer à une occasion unique d’apprentissage et de mise en pratique des connaissances théoriques acquises en salle de classe.
En effet, l’École de fouilles est souvent vécue comme une épreuve qui confirme ou infirme la vocation d’archéologue parmi les stagiaires. En d’autres mots, dans une école de fouilles, ça passe ou ça casse !
Cette annulation a aussi eu un impact sur la planification des études, car il a fallu trouver des cours de remplacement, en plein été, pour compenser cette perte de 6 crédits dans le plan d’études des stagiaires.
Pour leur part, les étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles engagés comme assistants de terrain ont raté une très belle occasion d’acquérir une expérience de travail professionnel rémunéré pendant leurs études.
Enfin, l’annulation de cette édition de notre école de fouilles ralentit considérablement les activités de recherche qui lui sont liées, puisque nous perdons ainsi une année complète de collecte de données.
Il est donc à souhaiter que les adaptations à cette nouvelle réalité nous permettent de retourner creuser le passé l’été prochain.
L’École de fouilles (Amérique centrale)
Christina Halperin, professeure agrégée au Département d’anthropologie
En raison de la pandémie, le cours ANT3857 – Patrimoine culturel en Amérique centrale, qui se déroule l’été au Guatemala, a été annulé.
Offert sur place dans des musées privés et publics, sur des sites archéologiques et dans des coopératives de tissage maya, ce cours propose aussi des conférences avec des expertes et experts latino-américains dans le domaine du patrimoine culturel.
Les visites et apprentissages visent à :
- Déterminer le rôle des Amérindiens et Amérindiennes mayas et des communautés locales dans la préservation de l’héritage culturel, du savoir de production et de la gestion;
- Explorer le rôle des établissements communautaires, internationaux et nationaux dans la gestion du patrimoine culturel;
- Développer l’apprentissage de l’archéologie et de l’histoire de l’Amérique centrale.
L’annulation a été une grande perte, car ce cours aide à développer l’intérêt des étudiants et étudiantes dans les domaines de l’archéologie, du patrimoine culturel, des études muséales et de la Mésoamérique.
Deux personnes poursuivant leurs études aux 2e cycle étaient également inscrits au cours. L’une allait l’utiliser comme tremplin pour explorer un projet de thèse de maîtrise et l’autre, comme base pour commencer à collecter des données sur le rôle des musées dans la gestion du pillage et des artefacts sans provenance.
À l’été prochain !
Des nouvelles du 1er cycle
Jorge Pantaleon, professeur agrégé au Département d’anthropologie
En ce qui concerne le 1er cycle, nous avons ressenti un impact considérable sur les grands cours et ateliers en laboratoire avec l’adaptation à l’enseignement en distance, qui a commencé en mars.
Heureusement, 70% du contenu des cours du printemps avaient déjà été couverts au moment où le présentiel a été suspendu. Lors de cette transition, les étudiants et étudiantes ont démontré une énorme souplesse et une bonne volonté.
Nous avons constaté une légère baisse d’inscriptions de nouveaux étudiants et étudiantes. En juillet, nous avons activé le programme de parrainage parallèle, ce qui permet aux nouveaux admis et admises d’être accompagnés et guidés par des étudiantes et étudiants expérimentés pour pallier les carences d’interactions directes et promouvoir des activités collégiales par l’association étudiante.
Du côté des cycles supérieurs
Bernard Bernier, professeur titulaire au Département d’anthropologie
Dans le cas des étudiants et étudiantes des cycles supérieurs, plusieurs problèmes se posent. Le plus important a trait à la recherche, en particulier celle sur le terrain.
Il a été impossible pour plusieurs de se rendre aux endroits de leurs recherches à cause des restrictions de voyage attribuables à la COVID-19. D’autres ont dû quitter leur terrain de façon précipitée, et plusieurs ont eu recours à des questionnaires ou entrevues en ligne pour obtenir des données.
En outre, la recherche a été repoussée à cause de la fermeture des bibliothèques. Enfin, l’isolement a aussi ralenti la recherche et la rédaction, tout en causant du stress et de l’angoisse et, pour certains et certaines, en diminuant la motivation.
La COVID-19 a causé des retards dans les dépôts de thèse ou de mémoire et dans les examens de doctorat. La lenteur des procédures administratives pour faire face à ces retards a amplifié le stress. Plusieurs ont eu des problèmes de Wi-Fi, ce qui a nui à l’accès aux cours en ligne.
Au sujet des inscriptions, la COVID-19 ne semble pas avoir causé de baisses importantes. Au contraire, à la maîtrise, il y a eu une légère hausse des admissions. Il faut noter cependant une diminution au doctorat, mais qui pourrait venir des fluctuations conjoncturelles.
L’une des conséquences de la COVID-19, c’est que les nouveaux étudiants et étudiantes internationaux n’ont pu entrer au pays avant septembre et ont donc dû suivre les cours en ligne. C’est le cas de 4 doctorants qui ont effectué le séminaire de doctorat en ligne en Iran, en Grèce, en Ukraine et en Colombie, alors qu’il s’est donné en salle pour les 5 étudiants et étudiantes se trouvant à Montréal.
Le LABRRI face à la pandémie et au confinement : l’expérience du ciné-club
Mathilde Gouin-Bonenfant, coordonnatrice du ciné-club
Le Laboratoire de recherche en relations interculturelles de l’Université de Montréal (LABRRI) est un lieu de recherche, d’enseignement et de développement d’expertise en relations interculturelles.
C’est rendu une évidence, voire un lieu commun, de faire le récit des derniers mois en commençant par notre surprise vis-à-vis de la pandémie de COVID-19. Comme tous les gens, nous n’étions pas préparés et préparées, individuellement ou comme laboratoire de recherche, à vivre une pandémie et un confinement, et à continuer de travailler dans ces conditions.
Toutefois – et je crois parler pour toute l’équipe du LABRRI –, nous ne nous sommes jamais sentis et senties aussi proches et solidaires que durant cette pandémie.
Après les 1res semaines d’ajustement, le LABRRI, sous l’impulsion de son directeur Bob White, s’est réveillé. Il semble que tout le monde a eu besoin d’un peu de temps pour organiser sa vie familiale, absorber le choc et retrouver une (relative) capacité de concentration.
À partir du début d’avril, nous avons redémarré les activités du laboratoire avec en tête, premièrement, la santé, la sécurité et le bien-être des membres du LABRRI dans ce contexte de confinement et d’isolement, mais aussi avec comme préoccupation la répercussion de la pandémie et du confinement sur les groupes minoritaires et vulnérables, ainsi que sur nos partenaires du domaine communautaire.
Les ateliers du LABRRI, que nous tenons normalement à raison de 1 fois/mois, se sont transformés en ateliers hebdomadaires, concentrés sur des thèmes liés à la pandémie : stigmatisation en temps de pandémie, distanciation sociale/physique, précarité du travail, mort et rites mortuaires, réseaux sociaux en contexte de pandémie.
À la suite de ces ateliers, nous avons publié des textes sur notre site web, qui résumaient et poussaient la réflexion sur ces enjeux. Nous avons aussi constitué un comité « solidarité » qui a répondu aux besoins urgents de certains organismes, grâce à l’engagement bénévole de membres du LABRRI.
Pour contrer l’isolement et pour assurer une cohésion durant le confinement, nous avons entre autres utilisé l’application WhatsApp, sur laquelle nous avons créé plusieurs groupes de discussion. L’un d’entre eux portait sur le ciné-club interculturel du LABRRI. Après en avoir rêvé pendant longtemps, au début d’avril, Bob White a proposé de finalement le mettre sur pied. Il m’a demandé d’en assumer la coordination, avec l’aide de Roxane Archambault.
Le contexte nous semblait idéal : confinement oblige, nous passions tous et toutes énormément de temps à la maison, et nos activités sociales et culturelles étaient réduites au minimum. Le ciné-club allait alors servir à la fois à nous divertir, à nous occuper, à nous rassembler, à briser l’isolement des membres et à continuer le travail du LABRRI sur les analyses interculturelles des films.
La formule du ciné-club est la suivante : les membres votent pour le film de la semaine (ou du mois), puis visionnent le film individuellement ou collectivement (ex. : par Netflix Party). Le dimanche soir, nous nous réunissons sur Zoom pour discuter du film. Ensuite, 1 ou 2 personnes se portent volontaires pour écrire un article de blogue que nous publions par la suite sur le site web du ciné-club.
Nous avons commencé par 1 film/semaine, mais, à partir du mois de juin, nous avons senti le besoin d’espacer les rencontres et sommes passés à 1 film/mois – rythme que nous maintenons toujours.
Notre bilan est le suivant : nous avons à ce jour tenu 8 discussions sur Zoom au sujet de 9 films différents, publié 10 textes sur notre blogue – que nous avons d’ailleurs créé pour l’occasion – et mis en ligne 6 travaux d’étudiantes et étudiants sur des films interculturels, à la suite d’un processus de révision.
Nous sommes maintenant en train de parfaire notre formule et de réfléchir à la programmation pour le semestre d’automne. Nous souhaitons rendre l’activité pérenne et rejoindre un plus grand auditoire.
Finalement, l’expérience du ciné-club a été réellement positive. La clé de ce succès, c’est, je crois, que nous avons su trouver un bel équilibre entre les aspects ludiques et intellectuels de l’activité. Je suis vraiment reconnaissante vis-à-vis des membres du LABRRI d’avoir fait preuve de créativité et de solidarité pour maintenir – et même renforcer – notre sentiment de collectivité.
Site web du ciné-club : cineclub.labrri.net
Dossier pandémie du LABRRI : labrri.net/dossier-pandemie et labrri.net/articles
L’enseignement à distance vu par un chargé de cours
 |
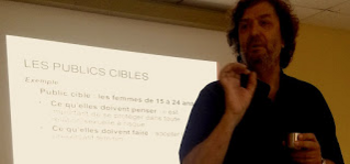 |
Richard Leclerc, concepteur-réalisateur publicitaire, chargé de cours en communication, universités de Montréal et Senghor (Alexandrie, Égypte)
Dans les années 1980, tout au début de ma vie professionnelle comme chargé de cours en publicité et en communication, je présentais les grandes lignes de chaque formation sur des acétates déposés sur la surface lumineuse d’un rétroprojecteur.
On regardait des annonces imprimées sur diapositives, on écoutait les messages radio sur cassettes et on analysait la publicité télé enregistrée sur des bandes vidéo ¾... Quelle différence aujourd’hui avec tous ces moyens technologiques mis à notre disposition !
Quand on nous a demandé de faire des accommodements par rapport à la COVID-19 pour terminer la session à distance, j’ai trouvé que l’expérience pouvait même être intéressante pour des étudiants et étudiantes. On pouvait ainsi utiliser le télétravail, qui connaît une popularité inégalée en ce temps de crise, pour échanger, mais aussi pour présenter le travail final.
J’ai donc continué à déposer du matériel pédagogique aux étudiants et aux étudiantes sur Studium, qui nous permet d’échanger par écrit des messages et d’envoyer des documents. J’ai aussi invité tous et toutes à télécharger l’application Zoom, pour qu’ils puissent se rencontrer à distance et discuter de l’avancement de leur travail en atelier.
Je passe ainsi 30 min/semaine avec chacune des 20 équipes. Alors que je donne habituellement 2 cours de 3 h, je prends maintenant 10 h à échanger avec eux et elles, sans compter les heures de préparation et de correction de travaux. Je n’ai cependant pas à me déplacer pour me rendre à l’Université, ce qui représente plus de 3 h/semaine.
Au moment où j’écris ces lignes, nous avons commencé les cours à distance depuis 2 semaines, et cela se passe très bien... du moins, de mon point de vue d’enseignant !